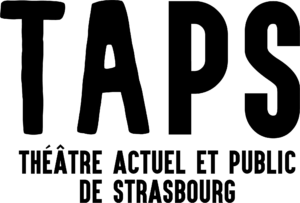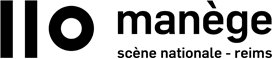Considérée comme l’une des chorégraphes les plus talentueuses de son pays, l’Islandaise Erna Ómarsdóttir signe un nouveau spectacle inédit, présenté en avant-première ce vendredi au Théâtre de Fribourg : « Orphée + Eurydice – Les cycles orphiques ». A mi-chemin entre danse et comédie musicale dramatique, la pièce revisite le mythe grec d’Eurydice et d’Orphée sous un jour très contemporain. Une collaboration entre les acteurs du Théâtre de Fribourg et de la compagnie Iceland Dance Company. Rencontre avec l’artiste à l’origine du projet, Erna Ómarsdóttir.
Comment pourrait-on résumer votre nouvelle création « Orphée + Eurydice – les cycles orphiques » ?
Erna Ómarsdóttir: C’est assez difficile à résumer. Le spectacle est basé sur le mythe d’Orée et d’Eurydice, mais c’en est une relecture, à laquelle se greffent d’autres histoires issues de la mythologie grecque, comme l’enlèvement de Perséphone ou encore la passion destructrice de Jason et Médée. Les mythes grecs sont des histoires qui ont été racontées de très nombreuses fois, ce sont des histoires connues, qui prennent racine dans une société où la manière de penser et de voir le monde était très différente.
Nous, ce qui nous intéresse, c’est de questionner cette ancienne vision du monde, de la mettre en perspective avec notre société actuelle, comme un miroir. Pour y arriver, nous sommes allés au cœur de ces histoires, puis nous avons gravité autour, nous avons créé des sortes de cercles autour d’elles, les cycles orphiques. Nous avons également travaillé la danse de manière cyclique, avec des répétitions de gestes. Cela donne une danse très physique, à laquelle on ajoute du chant, des cris, des respirations, comme une transe ou un mantra que l’on répéterait constamment.
Vous venez de mentionner le mythe d’Eurydice et Orphée, un des mythes les plus connus de l’histoire grecque. Pourquoi avoir choisi celui-là spécifiquement ?
L’idée m’est venue un peu par hasard. Je cherchais une histoire connue de tous, une histoire à laquelle les gens peuvent se référer et qui convoque des sentiments différents chez chacun. Il y a trois ans, j’avais repris Roméo et Juliette au théâtre du Gärtnerplatz de Munich, avec une troupe islandaise qui dansait sur la musique de Prokofiev. Là, je voulais quelque chose de similaire, et j’ai repensé à un ami à moi, Jóhann Jóhannsson, décédé il y a quelques années. C’était un grand compositeur et musicien, célèbre pour avoir écrit les musiques de films de certaines grosses productions hollywoodiennes [notamment « Premier contact » de Denis Villeneuve ndlr]. Son dernier album solo s’intitulait Orphée, et c’est comme ça que m’est venue l’idée. Ensuite, comme pour Roméo et Juliette, je ne voulais pas simplement raconter à nouveau l’histoire – ça a déjà été fait des centaines voire des milliers de fois – mais plutôt l’explorer puis l’utiliser pour créer une nouvelle histoire.
Revisiter des histoires anciennes – qu’il s’agisse de Shakespeare ou de la mythologie grecque – est une pratique assez courante au théâtre. Comment avez-vous fait pour aboutir à quelque chose de nouveau ?
Le processus de création a été assez long. Au début, nous étions trois : moi, Gabríela Friðriksdóttir, chargée de la scénographie et des costumes, et Bjarni Jónsson, auteur. Ensemble, nous avons écrit un script de base, que nous avons appelé notre carte routière. Dans cette carte routière, nous avons dessiné cinq cercles, avec dans chaque cercle, une histoire principale et plein de petites histoires qui gravitent autour. Nous avons aussi travaillé sur l’idée de paires, de duo, car il y en a beaucoup dans la mythologie grecque : Orphée et Eurydice, Jason et Médée, Demeter et Perséphone…
Ensuite, il a fallu créer un tout à partir de ces multiples petites histoires. Et ça, ça a été une réflexion commune, avec les acteurs et les danseurs, qui font partie intégrante du processus de création. L’idée était de pouvoir circuler entre ces histoires, de prendre du recul par rapport à elles, puis de se replonger dedans. Car si de prime abord ces histoires peuvent sembler un peu naïves, en réalité, elles ont de multiples facettes et elles nous servent de moteur pour aller plus loin et poursuivre la réflexion. Nous avons aussi cherché à créer différentes atmosphères, à faire passer des émotions, en utilisant plusieurs outils, la danse, le son, la texture du son, les mouvements. C’est une recherche permanente, qui donne une sorte de mix, qu’on aime appeler « comédie musicale borderline ».
Justement, pourquoi ce terme de « comédie musicale borderline » ?
Le mot peut paraître un peu confus, mais c’est ce que mon mari, Valdimar Jóhansson, et moi, avons trouvé de plus parlant. Nous travaillons en mêlant beaucoup de genres artistiques différents : la danse, les mots, le chant, les cris. Pourtant, ce n’est ni un spectacle de danse, ni une pièce de théâtre, ni un concert, ni un opéra. C’est tout à la fois. Les gens aiment créer des cases avec des frontières bien définies, dans lesquelles on peut tout ranger. Et bien nous, nous essayons de créer notre propre case, avec nos propres frontières.
Lorsque vous allez à un concert de musique pop par exemple, vous allez entendre les chansons de l’artiste, et entre les chansons, il va y avoir ce petit laps de temps, durant lequel l’artiste va peut-être dire quelques mots, un petit espace-temps qui ressemble un peu à un rituel. Et bien ce format là aussi, nous avons voulu nous en servir, pourtant il ne rentre dans aucune case.
Outre le format des concerts, ce sont aussi les chanteurs qui vous inspirent. Il y a de nombreuses références à des stars du rock ou de la pop des années 70-80 dans le spectacle.
Effectivement, nous nous sommes beaucoup servis des paroles de ces chansons des années 70-80 pour créer la pièce, car ce sont des titres que tout le monde connait et qui ont un côté très émotionnel. Prenons « Words » par exemple, de F.R. Davis, c’est une référence pour l’ancienne comme pour la nouvelle génération. Et ce qui est intéressant dans ces classiques, c’est la simplicité de la langue : les paroles de Kiss en sont un parfait exemple « I was made for loving you baby, you were made for loving me ». C’est simple, un peu ringard, mais quand on superpose cette ringardise avec d’autres éléments du spectacle, avec la scène d’avant ou celle d’après, ou selon la manière dont les acteurs et les danseurs disent, chantent ou crient ces paroles, ça leur donne une tout autre signification.
C’était ça l’idée : créer des couches et utiliser les chansons dans un nouveau contexte. Par exemple, le début des paroles de « The End of the World » des Aphrodite’s Child, [« Come with me to the end of the world, without telling your parents or your friends » ndlr], dans la bouche d’Hadès, Dieu des enfers, qui force Perséphone à le suivre dans les ténèbres, ça a une tout autre ampleur. C’est pareil pour les chansons qui parlent de solitude, et y en a beaucoup. On peut penser la solitude comme le fait d’être dans ses propres ténèbres, et à nouveau on peut explorer le monde d’Hadès.
En parlant de ténèbres, la pièce a plutôt une tonalité apocalyptique. Est-ce le message que vous souhaitez faire passer ?
C’est vrai que la pièce est assez apocalyptique, elle est sombre, sans espoir, très solitaire, elle fait ressortir la laideur de l’âme humaine. On peut avoir le sentiment que les personnages sont mauvais les uns avec les autres, que chacun se bat pour exister, pour prendre le contrôle et se faire entendre. Mais il y a aussi le penchant inverse : l’entre-aide et le soin. C’est ce que nous avons ressenti pendant le processus de création : même s’il y a eu des difficultés, qu’il a fallu faire face à l’égo de chacun, à la fin, il y a eu beaucoup d’écoute, d’entre-aide, nous avons dansé et joué ensemble. Et moi, personnellement, j’ai énormément apprécié ce dialogue qui s’est établi, c’était très beau et très réparateur, comme une grande embrassade. J’aimerais que le public ressente cela, qu’il puisse être inclus dans cette embrassade, qu’il reçoive un peu d’amour dans ce drôle de monde. Cela peut sonner ringard, mais j’aime être ringarde.
Donc c’est finalement une pièce plutôt optimiste ?
Je pense que tout n’est pas noir ou blanc, la vie est faite de nuances de couleurs. Il peut y avoir quelque chose de sombre ou d’idiot, et juste après ou juste avant, quelque chose de gai. Ce sont ces contrastes qui sont intéressants, ils sont comme les différentes strates de la vie. J’aime aussi me référer à l’idée du voyage : ce qui compte ce n’est pas le fait d’aller d’un point A à un point B, mais les chemins qu’on prend pour y aller. Dans la pièce, on évoque l’histoire grecque de la quête de la toison d’or. Mais une fois que vous avez obtenu la toison, ça ne veut pas dire que vous avez réussi quoi que ce soit. C’est comme obtenir un Oscar, un Golden Globe, la première place aux jeux olympiques. Ce qui importe c’est que vous avez bataillé pour en arriver là.
On peut d’ailleurs appliquer le même principe à l’amour. Trouver l’amour de sa vie, c’est un but en soi pour de nombreuses personnes. Mais une fois qu’on a trouvé cet amour, est-ce-que ça veut dire qu’on s’arrête là ? Il y a aussi l’image de la muse : la muse a souvent été utilisée par les artistes – principalement masculins – comme objet de création. Ils imaginent qu’ils aiment quelqu’un, ou qu’ils ont perdu quelqu’un, et ça leur permet d’écrire et de composer des chansons. C’est intéressant de se dire qu’il leur faut une muse pour garder l’inspiration. C’est aussi intéressant de voir la place qu’on donne à ces femmes-là.
Il y a donc une portée féministe dans votre nouveau spectacle, comme c’était le cas pour Roméo et Juliette à Munich il y a 3 ans ?
Oui, bien sûr, c’est une pièce féminine. Je pense que la plupart d’entre nous sommes d’accord pour dire qu’il y a quelque chose qui a foiré dans notre monde capitaliste actuel. Mais peut-être aussi que ça avait déjà foiré il y a des milliers d’années, à l’époque grecque, puisque c’était là aussi un monde très masculin, rempli de testostérone. Aujourd’hui, nous en faisons tous partie, je ne suis pas meilleure qu’une autre. Mais moi, j’ai envie de réparer ces erreurs et de redonner aux femmes une meilleure place dans le monde.
Pourriez-vous nous décrire le style de danse que l’on retrouve dans le spectacle et votre manière de travailler ?
Pour créer mes spectacles, je me base d’abord sur des idées simples, presque abstraites, qui font parties depuis longtemps de mon vocabulaire artistique et qui me permettent ensuite de raconter des histoires. Je vais par exemple entamer un mouvement de balancier, dodeliner la tête ou basculer mon corps d’avant en arrière. Si on répète ce mouvement encore et encore, il va finir par se transformer et se métamorphoser. C’est une évolution infinie. On peut comparer ça aux vagues de l’océan. Je pense qu’il faut faire confiance à notre corps, il est très intelligent, il pense tout seul et nous dit quoi faire ensuite. Tout est déjà dans l’inconscient. La signification des choses va venir d’elle-même, sans qu’on ait besoin de se dire « mais pourquoi je suis en train de faire ce cercle ? ». Le moment où subitement on arrête de tourner est aussi un moment très intéressant. De même que les mouvements de groupe, un groupe qui se forme, des constellations qui se créent. Ce sont tous ces gestes qui sont les moteurs de la chorégraphie.
Et qu’en est-il de la musique ? Est-ce aussi ce même principe de répétitions cycliques ?
Oui, et là encore, c’est le corps qui nous guide. J’utilise beaucoup la voix, pas uniquement pour le chant, mais comme texture. J’aime les sons primaires que nous sommes capables de produire, ceux qui viennent du plus profond de notre être. Le cri par exemple. Un cri n’est pas juste un cri, il y a plein de manières différentes de crier, et je suis assez pointilleuse sur ce sujet-là. J’ai beaucoup utilisé le cri au cours des dernières années. C’est une technique qu’il faut travailler, qu’il faut apprendre, il faut renforcer ses cordes vocales, comme on renforce son corps pour la danse, c’est une action très physique.
Je travaille aussi sur la respiration et là encore on retrouve l’idée de répétitions et de cercles infinis. Au cours des siècles passés, on a beaucoup utilisé la respiration pour se calmer, pour se soigner, comme dans la méditation ou quand on entre en transe. C’est la même idée. De manière générale, la musique du spectacle n’a pas été créée en parallèle de la danse ou des dialogues, c’était un tout, un voyage conjoint. Et toutes ces parties viennent se superposer, toujours dans cet esprit de créer des couches.
Globalement, comment s’est passé le travail avec les acteurs allemands et les danseurs islandais ?
C’était très beau. Quand on a commencé à danser ensemble, sur des exercices simples, il y a eu une sorte d’alchimie qui s’est créée, acteurs et danseurs ont fusionné. C’était comme s’il n’y avait pas eu de différence entre eux. Alors que des différences, il y en a, chacun à sa spécialité et ses compétences, mais ils ont réussi à se connecter. C’était très beau de voir grandir et émerger ça. Ils ont pris soin les uns des autres, il y a eu beaucoup d’amour et de partage. Chacun a appris de l’autre, les danseurs des acteurs et vice versa. Après, ça n’a pas toujours été simple, car il est parfois difficile de mêler ces deux formes d’art.
Pour les acteurs par exemple, on a beaucoup travaillé sur le lâcher-prise, car ils sont beaucoup dans l’intellect, dans la tête et non dans le corps. C’est lié à leur apprentissage, et on ne voulait pas totalement se débarrasser de ça, mais on souhaitait que le corps parle plus. En ce qui me concerne moi, c’était très enrichissant, car on me posait souvent des questions, et c’est bien d’être remis en question, pour s’obliger à être plus clair, mieux se faire comprendre. Quand je dirige un spectacle, je ne suis pas dans la salle à regarder ça d’un regard extérieur, je viens sur scène, je suis à l’intérieur même du chaos, pour faire bouger le moteur depuis l’intérieur.
Interview : Tatiana Geiselmann
Le 13 décembre 2021, visioconférence
Photo : Thomas Kunz