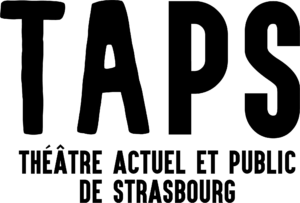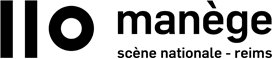Dans une période où les artistes sont éloignés des scènes et privés de revenus, #szenikmag a donné la parole à l’artiste-performeuse Cécile Serres. Dans une interview, par Marion Coindeau, elle parle de sa pièce « Trapped in a quotidien of reproches » et de la précarité des artistes.
Marion Coindeau : La pièce Trapped in a quotidien of reproches que tu as conçue en 2019 est un hybride de toute part : titre mêlant français et anglais, comédie musicale en lip-sync qui réunit plusieurs performers, scènes jouées lors de la représentation côtoyant des moments filmés, des images de synthèse et des effets spéciaux, des compositions musicales accompagnées de sous-titres dissonants. J’ai le sentiment que tu as construit cette œuvre comme une toile géante, tissée à plusieurs, qui porte une histoire commune. Peux-tu revenir sur le titre et la genèse de ce projet débordant ?
Cécile Serres : Quand Marie Griffay (directrice du FRAC Champagne-Ardenne) m’a proposé de participer au festival Reims Scènes d’Europe avec la création d’une performance originale, j’occupais un job alimentaire dans une grosse institution du spectacle parisien. J’étais barmaid là-bas.
Le stress s’y distillait de pleins de façons différentes, avec un salaire trop bas et qui variait tous les mois, le loyer de l’atelier et les pièces à produire. Toute l’équipe du bar était plus ou moins dans la même situation : artistes en devenir à différents endroits du spectre, coincé dans un purgatoire de bière collante en attente de l’accomplissement de leurs “Grandes Espérances”. A la grande frustration que nous ressentions du fait d’être rassemblés entre personnes désirantes et créatives sans pouvoir en profiter, s’ajoutait cette pression quotidienne d’une organisation méprisante et ingrate. La politique salariale dégradée, nos emplois plus précaires que jamais, la programmation n’a pas tardé à se gâcher et le public se faire rare.
Depuis la fin 2018, nous étions tenus pour responsable de cette chute, suspectés de voler, d’être grossiers, de faire fuire le client parisien. Cette montagne de reproches venait en rencontrer d’autres, familiales et personnelles, une partie de notre entourage ne comprenant pas que notre devenir artistique (comme elles se le figurent) mette tant de place, de temps et d’énergie à s’accomplir. Les bourdonnements incessants des remontrances multiples étaient comme des acouphènes dans mes oreilles, une petite musique de fond qui berçait journée.
Le titre est tout cela. Trapped in a Quotidien of Reproches exprime un sentiment d’arasement insoutenable qui dépasse les mots. La vocalité du mot “Trapped” m’apparaissait comme infiniment plus dramatique que “coincé.es”. Dans un franglais composite, le titre exprime un trop plein, un collage, un montage de fortune. Il introduit également le décalage ironique qui sous-tend la pièce. Le langage mixte, la parole transposée est une clef dans la construction de la pièce. La dynamique du bricolage a également guidé la mise en oeuvre du travail.
Quand on m’a proposé le projet, j’ai voulu étendre au maximum les possibilités qui nous avaient été données à partir de ce canevas partagé avec mes collègues, devenu.e.s mes performers. Occuper toute la scène de théâtre, tout le créneau, tout le budget de production, tout le temps imparti. Être “too much”. Non par avidité , mais parce que cette mise sur “mute” de notre équipe devait s’achever en une profusion du dire, s’affirmer dans une explosion de rire grimaçant. C’est l’ironie de “Trapped” (Piégé.es) : dans un soucis de détournement, notre lieu de travail, notre plateau de tournage secret, notre équipe, réunie au hasard de notre manager, devenait une troupe autonome mue par le même sujet.

M. C. : Les personnages sont tiraillés entre leur travail alimentaire supposé les rattacher à la société et leur travail artistique relégué à une forme de clandestinité, et dont la satisfaction d’une vocation serait plus importante que toute rémunération. Cette double vie reflète une réalité pour beaucoup de jeunes artistes qui, sortis de l’école, se retrouvent dans un entre-deux particulièrement précaire, n’ayant pas encore pénétré l’ ”économie de l’art” et ses réseaux d’influence mais ne pouvant pas pour autant se consacrer exclusivement à un “day job”.
C. S. : J’ai toujours travaillé “à côté de” – mes études, ma pratique, un autre boulot. C’est normalisé dans notre cas, rien de plus classique. Cependant, insidieusement s’opère un volte-face : peu à peu c’est la pratique artistique elle-même qui devient un “à côté”. C’est très dangereux, car en devenant une forme de passe-temps elle perd sa charge révolutionnaire. Et puis survient aussi ce sentiment d’attente infinie, attente que cette situation, pour une raison ou pour une autre, cesse. Le pire pour moi c’est bien cette “mise à plus tard”, quand on pourra vivre sa “vraie vie”. Tout cela dans la crainte de s’épuiser, d’être contraint.e.s à abandonner. J’ai toujours eu le sentiment que mes patrons volaient sciemment ma force de travail, normalement allouée à ma pratique. Mon capital travail détourné par un directeur de magasin trop zélé, la sensation d’être impuissante à protéger ce qui est le plus important.
Les exigences sont elles aussi très diverses : docile en début de journée au travail, prolixe et libre à l’atelier, muet au second travail… pas facile parfois de devoir être plusieurs personnes dans la même journée ! Cependant, une pratique se réalise au présent, et je suis persuadée qu’elle est nourrie de nos différentes casquettes, pour peu qu’elles nous en laissent l’énergie et les moyens. Il n’y a pas de scénario idéal, mais je pense que si les structures qui invitent des artistes à travailler pouvaient nous rétribuer de manière significative, ce serait déjà bien. Nous n’avons pas le droit au chômage, il faut donc que nous puissions vivre sur nos peu de factures, que les structures tiennent compte de cette réalité.
Dans l’imaginaire collectif, “la débrouille” est un corollaire pittoresque qui accompagne le personnage du jeune artiste. Or il n’y a rien d’amusant à devoir reporter ses soins, payer son loyer en retard, galérer pour manger, se déplacer. En plus d’être tenus pour responsable de cette situation, parce que nous l’avons “choisie”. C’est bien le nerf de la guerre, partagé à la fois par les artistes qui vivotent grâce aux petit boulots comme pour ceux qui sont plus inclus dans le système marchand : ce risque de se flapir, asséchés à force d’être pressés comme des citrons et de vivre de multiples concessions.

M. C. : La précarité qui traverse Trapped m’évoque beaucoup celle décrite par Judith Butler. Comment on fait l’expérience d’une précarité quotidienne, individuelle, et comment elle devient la condition partagée d’une expérience en groupe. Ton travail porte cette conception d’un sujet existant d’abord à travers ses relations, conscient de la vulnérabilité de son corps dans cette interdépendance primordiale. Butler a cette phrase “Nous sommes (dé)faits les uns par les autres” qui me semble faire justement écho à la façon dont tu as composé cette œuvre.
C. S. : Au départ je faisais des installations, désespérément vides comme des aquarium témoins. Elles présentaient une attente, le moment critique avant la péripétie. Il faut croire que je n’ai pas pu me résoudre à faire cette croisière en solitaire face à l’objet inanimé. Ma volonté d’écrire des performances est d’abord née de ma façon de tisser des personnages fictionnels autour de personnes dont la rencontre avait marqué mon imaginaire immédiat. Les performers occupent leurs propres personnages augmentés, étendus par un script que je les laisse interpréter librement. Comme une vision, la rencontre est un déclencheur fort en moi, principalement parce que je me laisse bouleverser par elle, je dramatise et extrapole. Peu à peu, j’ai eu le sentiment qu’en composant une gamme de personnages, j’échafaudais une sorte de famille terrestre à la généalogie étoilée. Le fait de demeurer à l’extérieur de ses incarnations me permet également d’observer cette projection, de faire du corps de l’autre cet écran interdit (j’ai souvent peints mes performers). J’ai besoin d’évacuer de ma pratique l’écueil de l’auto-écriture, d’un “je” solidement arrimé. Pour cela je dois renoncer à en être la seule auteur-compositrice-actrice.
En confiant l’incarnation d’un moment de mon travail à un autre, je rebats les cartes : je dois m’en remettre à lui pour que ce que je produise aille prendre l’air, s’échappe à nouveau, me revienne en boomerang avec étrangeté. Ces corps étrangers qui viennent prendre en charge ces morceaux de travail sont des rencontres mutagènes, nécessaire à ma dynamique d’écriture. On m’a souvent demandé si j’étais sadique car je mets parfois mes performers dans des situations qui semblent inconfortables, mais en réalité je pense que je cherche plus à me rendre vulnérable dans l’accomplissement du travail par un.e autre. C’est un exercice d’infinie confiance, de défi, de transmission de pensée, un pari dont on ne connaît l’issu qu’à la fin de la performance.

M. C. : Tu parles d’une “famille” qui s’est formée au cours de ce projet, de sa création en commun où chacun avait un monde à soi – Aram Abbas a composé la musique et Elliot Gaillardon a réalisé les images et les effets spéciaux. Comment a vécu ce réseau éphémère alimenté par l’énergie de Trapped ?
C. S. : Entre personnes pratiquant la performance, la musique, la danse, la comédie ou le film, nous sommes souvent amené.es à unir nos forces et faire groupe pour faire scène – ou plateau. Ce projet en a généré d’autres, je pense qu’en réalisant Trapped nous nous sommes dit que tout était possible, ça a été un formidable vecteur d’émancipation. Aram Abbas a produit un disque avec les chansons, en duo notamment avec une autre artiste, Felise de Conflans. Elliot Gaillardon, Maxime Villéger et Hugo Rigal travaillent également sur un projet musical, avec Dounia Diop. Yohan Vallée et Maxime sont régulièrement sur scène ensemble. Notre collaboration repose sur des motivations profondes, le désir et le jeu, ainsi qu’un lien idéologique très fort. Si le projet ne s’est joué qu’une seule fois, notre alliance informelle perdure sous différents projets, bien que nous aimerions occuper à nouveau les personnages de Trapped.

M. C. : La vulnérabilité et la confiance que tu évoques sont des compagnes essentielles de la performance. En mobilisant la vulnérabilité des personnages et des moyens comme une ressource artistique et critique, j’ai l’impression que tu as réussi à transposer l’énergie de la performance à la scène, à ébranler le cadre et la distance que celle-ci impose.
C. S. : Le 2 février 2019, le public a vu débarquer sur scène ce que nous avions à lui montrer : une boule d’énergie que nous avions mis trois mois à faire grossir. D’ordinaire, je joue les performances sans organiser de répétitions, elles n’existent que dans l’instant de la présentation. Ici, c’était nécessaire, mais nous avons tout de même souhaité conserver la charge liée à l’improvisation qu’exige la performance. En guise de répétitions, les couloirs de la boite et mon atelier accueillaient des mises en place schématiques, car rien ne pouvait nous donner l’échelle de la scène sur laquelle nous devions jouer. Cette aspect a eu son importance lors de la représentation. Un fois sur scène, les corps et les objets ont pu s’étaler dans l’espace dans une dynamique générale d’extension.
Je pense que c’est cette effusion qui a été transmise de manière privilégiée au public. Certains m’ont dit qu’ils avaient l’impression que nous allions déborder hors scène en permanence ! C’était donc une production encore en fusion que nous proposions en connaissance de cause. Je voulais que le public se sente débordé, qu’il plonge avec nous dans cette performance de l’implosion et surtout dans l’immédiateté de ce travail à peine achevé, à la lisière de l’amateurisme, dans une esthétique de générale DIY. Au-delà de ce spectacle qui n’en était pas un, la performance proposait une expérience de reprise de liberté enclenchée tout au long du processus, de notre jouissance à prendre le revers de notre quotidien, à devenir puissants en nous découvrant une forte intimité artistique.

M. C. : La reprise de liberté dont tu parles lorsque vous vous emparez de la scène s’articule avec la prise en main totale des moyens de production de la pièce. Dans cet élan de révolte, tout le monde a mis la main à la pâte créant une organisation do it yourself qui dépasse le simple manque de moyens matériels. Cette énergie saisie et imparfaite n’est pas seulement dérivée des conditions d’existence de Trapped mais se retrouve ailleurs dans ton travail plastique et écrit, comme un procédé punk.
C. S. : Mon travail à l’atelier et à l’écrit est en réalité très semblable. J’aime que les formes, littéraires ou visuelles existent dans une certaine immédiateté. Un costume doit encore avoir cette forme de la colle chaude, le silicone encore dégouliner d’une pièce, un texte résonner de ma voix mentale encore en train de dicter. Aussi, je travaille avec les moyens du bord le plus souvent, et doit inventer des techniques afin de pouvoir tout réaliser moi-même, tout de suite. Fabien Hein définit le Do It Yourself (DIY) dans son ouvrage Do it yourself ! Autodétermination et culture punk, comme une « disposition humaine tendue vers la résolution de problèmes pratiques”, “synonyme d’autonomie et d’indépendance”.
Ce que je produis est donc très tributaire de ce qui se trouve autour de moi, ce avec quoi j’ai l’urgence de composer. Il me faut travestir ces éléments, les faire correspondre à une fonction précise. De plus la plupart des objets que je produis sont performatifs, et doivent donc subir une transformation importante au fil des performances. J’ai beau avoir une passion ultime pour le matériaux, dont certains aspects tournent presque au fétiche (comme le latex ou le silicone), l’objet reste un support pour une énergie dirigée pendant la performance. Les exigences esthétiques que j’ai par rapport à un objet résident moins dans son “fini” que dans sa charge tragi-comique. Voués à muter, les textes et les objets continuent bien souvent leur existence propre assez loin de ce qui leur était destiné au départ, et j’accueille volontiers ce décalage entre intention et résultat.

M. C. : La scène d’ouverture met en présence les quatre personnages drag qui se présentent selon les codes classiques du ballroom, défilant sur le runway dans une affirmation exacerbée de soi, de sa force et de ses qualités – montrant le plus de “charisma, uniqueness, nerve and talent” pour reprendre les mots de RuPaul. Ces figures sublimatrices associées au monde de la nuit contrastent avec les paroles prosaïques qu’elles chantent :
« Être fabuleu.es.x ne nous dédommage pas – Être talentueu.es.x ne se mange pas». Pourquoi avoir recours à cette forme d’altérité ?
C. S. : Le drag représente pour moi un mode d’auto-détermination dans l’adversité, un parti pris de l’affirmation de soi dans un contexte de précarité. C’est aussi une communauté qui repose sur la transmission d’un savoir oral, de l’entraide et du soin. Les leviers comiques tels que l’ironie ou l’autodérision y tiennent également une place centrale, si bien que l’on est moins en présence de la célébration de soi-même que d’une célébration collective de la performance. Jouer un rôle est un exercice quotidien, de la même façon que lorsque l’on ruse pour cumuler plusieurs casquettes, au travail, sur scène, à l’atelier. Ce qui m’intéresse dans la forme de drag que nous avons choisie de performer, c’est la possibilité de célébrer un “amateurisme” exacerbé élevé au rang d’art de la scène. Il y a un développement d’astuces et de savoir-faire pour s’inventer avec les moyens du bord, dans le détournement et la sublimation de matériaux et d’objets.
J’ai laissé mes performers choisir leur nom de scène, et été très attentive à leurs envies et suggestions par rapport à leur rôle. Tous avaient envie de pratiquer le drag, sans pour autant trouver le moment ou le lieu de le faire. J’ai écouté leurs propres aspirations, car il était important que cette expérience s’écrive à plusieurs. Dans le cadre de cette comédie, les personnages sont des “infiltrés” dans leur travail alimentaire. C’est cette situation qu’ils vivent comme un travestissement. Au fur et à mesure de la pièce, la mue de leur emploi tombe et ils apparaissent peu à peu dans leur personnage drag d’une manière punk en s’émancipant en criant “me voilà”.

M. C. : Pour moi, la parole est l’un des points essentiels : comment elle était étouffée par vos personnages professionnels derrière le bar et se trouve libérée par la pièce, tout en exhibant sa vulnérabilité à travers le lip sync (parole muette couverte par la voix d’un autre) ou du yaourt chanté (nouvelle langue inventée et incompréhensible). Ce décalage participe pleinement à l’humour subversif de la comédie musicale, se joue des dévoilements et des trames narratives de la pièce.
Comment as-tu composé (avec) ces différentes voix ?
C. S. : J’ai commencé à pratiquer le lip sync (playback) en performant au Studio Galande devant le film The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman. Les sous-titres sont l’aire de jeu des acteurs devant le film. Quand j’ai écrit cette fiction, elle m’est immédiatement apparue sous la forme d’une comédie musicale. C’est une épopée initiatique, avec les grands composants du genre : un dragon à abattre (le manager) afin de s’émanciper, la consécration d’un individu, une histoire d’amour interdite.
Nous voulions que chaque élément ait la même importance sur scène, que tout joue, que tout écrive : les acteurs, la vidéo, la musique, les sous-titres, les sculptures et le texte. Les chansons ont précédé les “paroles”, j’ai donc composé “par-dessus” et avec la musique d’Aram. De la bouche des acteurs semblaient sortir des sons muets, sur lesquels j’ai apposé des mots. Ils disent malgré eux en quelque sorte.
Ce qui rend la formule comique dans le lip sync en général, c’est ce mimétisme de la voix enregistrée, qui rapproche le corps de l’acteur de l’automate.
Trapped est une pièce muette mais qui ne se tait jamais, qui chante toutes nos paroles étouffées ou fredonnées en secret.
Trapped in a Quotidien of Reproches
Comédie musicale en lip-sync conçue par Cécile Serres sur une composition originale d’Aram Abbas. Images et effets spéciaux Elliot Gaillardon.
Avec Elliot Gaillardon, Antoine Granier, Christian Kimena, Cham Lavant, Garush Melkonyan, Hugo Rigal, Cécile Serres, Yohan Vallée et Maxime Villeléger.
Captation et montage : Anne Charlotte Rouxel
Présentation de la pièce :
L’équipe d’entretien et de service d’une grande entreprise d’événements culturels s’apprêtent à préparer la grande compétition voguing de l’année : Le Bal. Chacun d’entre elles.eux a une double vie artistique, qui contraste avec la précarité de leur travail ingrat, et elles.ils rêvent d’enflammer les planches. Lors d’une séance de coordination d’équipe corporate (une sorte d’exercice de management new wave), offerte par l’entreprise et obligatoire, un génie malicieux leur apparait et leur suggère un plan diabolique afin d’obtenir le graal : une place sur le runway de la gloire.
Les questions ont été posées par Marion Coindeau.